Je voulais être costumière. L’écriture n’était pas pour moi un métier. On avait passé l’âge pailleté où l’on pouvait en vivre honnêtement à moins d’être une vénérable « tête de cul poudrée », un « détenteur de sourire de lavabo pour grabataires finissants » venu éructer cathodiquement les prémisses tragi-anecdotiques qui allaient mener à un incipit claudicant.
Mais pour ce faire, il aurait fallu que je traverse les grandes plaines canadiennes, que je survole les lacs Winnipegosis et Ontario, la rivière Rouge, la rivière Assiniboine, pour me retrouver dans un placard (meublé) à Toronto. Mais les petites métisses de bonne famille ne vont pas apprendre seules dans une mégapole les fantaisies de l’étoffe garancée… « sera ensuite bouilli avec alun, tartre ou gravelle, et après garancé avec garance commune, ou croûte de belle garance, et parachevé en noir avec noix de galles d'Alep. » Elles restent au creux de la main familiale et se laissent bercer par la douce illusion d’un parcours en lettres modernes, de plats chauds trois fois par jour, d’ablutions et de lessives gratuites.
Il existait d’autres solutions bien sûr. J’aurais pu trottiner à travers l’Amérique du Sud comme le faisait mon frère, l’étendard d’une ONG, des baskets éculées et la dysenterie résultant de pitances de hamster haché mâchés au bord d’autoroutes comme seuls compagnons. Prendre du galon de Rebelle humaniste. Mais je n’étais pas entièrement convaincue qu’un BFA en Fashion and Costume Design n’allait pas me mener ailleurs que tout droit aux caisses d’allocation chômage de l’État canadien. Non pas qu’un diplôme en lettres ne garantisse un avenir tout aussi brillant.
Je me suis contentée de quelques cours introductoires d’arts dramatiques – design, écriture, analyse et interprétation confondus. Le département de théâtre se trouvait au sous-sol d’un stigmate architectural des années soixante-dix. Ceux qui y affluaient étaient de teinte grise, sans nul doute atteint de scorbut, mégalomaniaques, endogames, pathologiquement zélés. Les profs n’étaient pas mieux et avaient ajouté à leur répertoire la dipsomanie, la lubricité, des posters défraîchis de films serbo-croates sous-titrés en alsacien dans leurs bureaux. Je n’appréciais pas particulièrement Stanislavski et encore moins ses adeptes. Jouer vrai à tout prix même si le jeu est mauvais. On aurait dit une proclamation de l’ère post-post-post-moderne, une exhortation à la médiocrité, une consécration d’une carence de l’effort, le mildiou de l’esthétique, la vie contemporaine en somme. Et où pouvais-je aller puiser le fétide mélange de désespoir, de douleurs, d’abdication, la rage impotente, la hargne vengeresse d’une reine Margaret en proie au maléfice de Richard III ? J’avais eu une enfance heureuse, n’avait jamais perdu mon doudou dans le métro, était restée essentiellement blasée face aux ruptures amoureuses, n’avait jamais touché le froid cadavérique d’un locataire de cercueil ; on n’avait pas écrabouillé mon chat dans la rue par un après-midi ensoleillé de juillet… je n’avais pas de chat. Je déteste les chats. Leur roucoulade lancéolée, leurs vaines voltiges tape-à-l'oeil de gymnaste soviet, leur ductilité impudique, ces yeux de fumée de cadmium ébouillanté, l’arrogance des boulettes de poils et de morve qu’ils laissent dans leur sillage, leur coquetterie fat de midinette, la toilette linguale... Saloperie de bête !
Je n’avais pas de compendium émotif, de mémoire affective dans lequel puiser un personnage de veuve hystérique et brisée dont on avait assassiné tous les enfants ! J’ai laissé derrière moi le Russe gominé, les zombies couleur poussière, les fins pédagogues biberonnés au bourbon et les quelques croquis préliminaires de costumes commencés pour les quatre chères vieilles tarées d'une production imaginaire de La Folle de Chaillot et j’ai émigré quatre étages plus haut dans la tour de Babel, au département de langues modernes, d’où je suis ressortie quatre ans plus tard lardée de falbalas honorifiques qui ne valent pas tripette dans la rue. J’ai lourdé Ma vie dans l’art mais j’ai gardé les croquis.






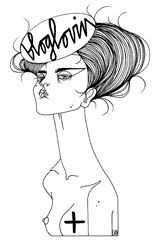



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire