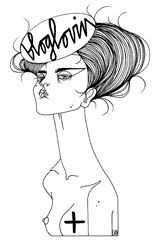Je ne suis pas une adepte de la déclinologie contemporaine ni une pleurnicheuse nécrologique des littérateurs passés. Mais j'aime beaucoup les arbres. Et la littérature. A choisir entre les deux, je prends le parti des arbres. La littérature se doit donc d'avoir une très bonne excuse pour venir empiéter sur l'existence d'un arbre. On n'assasine pas impunément une forêt pour y imprimer la preuve écrite de sa médiocrité! Merde!
Il est vrai qu'il était une fois, un peu longtemps de cela, dans un pays lointain, je me destinais à écrire une thèse sur l'écriture du corps pornographique dans la nouvelle québécoise... vaste programme. Certains arbres l'ont échappé belle. Il est vrai qu'à force de lire Kristeva, Cixous et Benveniste, de disséquer les canons et tout ce qui gisait aux alentours, d'avoir sombré dans les affres de la narratologie, de s'être raccroché un moment à Lévinas et d'avoir rejeté Lacan en bloc... sauf pour le jeu jouissif de la citation, ma cervelle de lectrice était moisie de critique formaliste, creuse et vaine.
Je me suis risquée il y a peu, pour les nécessités du prix littéraire local (alias prix Roblès, alias Goncourt du premier roman) décerné en partie par le public (... démocratie utopique de la chose culturelle?), à tâter de la page écrite contemporaine. Des djeunes ou tout comme qui nous livraient leur premier roman. Un beau préambule. Qui malheureusement s'arrêta là. Je découvrais les limites exigues de la considération publique de la littérature. Les organisateurs, auto-proclamés "professionels du livre" s'étaient façonnés une pureté fictive du roman ne reposant sur rien de concret sauf quelques claudicants préjugés qu'ils voulaient bien se partager... le "roman" ne devait pas être trop court (encore ce mépris franco-français pour la nouvelle) mais était souvent bien trop long (voir plus loin), était vaguement détaché de tous les autres genres n'étant ni policier ni historique ni quoi que ce soit d'autre, avait une essence et une pureté originelle de roman... un minestrone de clichés absurdes en cascade. Le roman, dans l'Antiquité désignait tout simplement une histoire d'amour. De plus, les livres de la sélection 2010 allaient dévoiler leur lot de caractéristiques non-romanesques, extra-romanesques, méta-romanesques, trans-romanesques s'il fallait se fier à l'idée fixe des organisateurs.
"En sélectionnant parmis les représentations possibles du fait littéraire l'une d'entre elles, qui en présuppose le caractère essentiel"
(Alexandre Gefen, "Ma fin est mon commencement: les discours critiques sur la fin de la littérature",
LHT [En ligne], N°6, LHT, Dossier, mis à jour le : 10/06/2009, URL :
http://www.fabula.org/lht/6/dossier/118-gefen.) on en vient à ignorer tout le reste. D'autres richesse insoupçonnées, des possibilités et des horizons sans fins. Que faire du brouillon? De la tentative inaboutie? De l'inclassable? Du métissé? Du balai! Ce serait trop simple. "Roman". C'est une gommette marketing qu'un éditeur fait coller sur ses bouquins pour assurer leur vente et faire comme tel est trop souvent le cas, la
"promotion d'une littérature facile d'accès, adapté aux faibles capacités de lecture et de concentration du grand public" (Olivier Bessard-Banquy, "Du déclin des lettres aujourd'hui",
LHT [En ligne], N°6, LHT, Dossier mis à jour le : 10/06/2009, URL :
http://www.fabula.org/lht/6/dossier/113-bessart-blanquy.)
Lorsqu’on est plus « tendre » et que l’alcool et l’âge n’ont pas fait oublier sa théorie on se dit que toute considération de genre en tant qu’élément taxinomique ne permet que la classification du livre par ses « professionnels » et fonctionne « comme un schéma de réception (…) comme code littéraire, ensemble de normes, de règles du jeu [informant] le lecteur sur la façon dont il devra aborder le texte, [et dont la réalisation devrait inviter] à corriger la vision conventionnelle qu’on a du genre dont le texte serait la réalisation, comme langue sous-jacente au texte considéré comme parole. » (Antoine Compagnon. Le démon de la théorie. Seuil. 1998.) Les contraintes génériques sont une accumulation de conventions historiques. Une relique millénaire en somme. Le genus dicendi. Une béquille de l’Antiquité qui rend infirme quiconque insiste à s’y appuyer. Un détritus aristotélicien qui fait se vautrer ses partisans dans la triade carcérale du sublime, du tragique et du grotesque… l’histoire, la romance et la satire… le haut, le moyen et le bas… ce que Barthes appelait la travaillée, la neutre, la parlée. Aujourd’hui ça donne… l’autofiction et l’étalage solliptique de pseudos-intellos dont la posture scoliotique les mène à fixer le trou qu’ils ont au milieu du bide qu’a laissé un ancien, flétri et regretté cordon ombilical ; suivi des formes trop courtes pour être considérées sérieusement (nouvelles, novelas), ou trop alambiquées pour être facilement digérées du plus grand nombre (écriture expérimentale, poésie, transgenre et intertextualité en tout genre) ; et puis les rogatons, les oh-mais-jamais-je-ne-m’abaisserai-à-lire-cette-lie-là-Madame ! (les romans poulaga, la science fiction, la BD et j’en passe et plus si affinités). Ce genre de structuration est hautement handicapante, amenuise les possibilités de l’intertextualité, du dialogisme, de la polyphonie. En voilà une triste folie qui tourne en robe grise !
Et puis il y a la question du style. Cette notion torturée ! Triturée ! Tarabiscotée par des têtes de culs poudrés mal torchés ! Mais ce serait trop long…
Je me suis attelée à la lecture de la sélection. Je ne me connaissais pas autant de réserves masochistes. Avant le meurtre (des trois premiers "romans" lus) une apologie...
"Quel critique, en vérité, serait sûr de surmonter dans ses jugements les risques épistémologiques qui s’hérissent entre notre inéluctable myopie et ce qui devrait être un bulletin de santé de la littérature ? Il s’agirait de dépasser ce qu’on nomme en sciences humaines le biais de représentativité et de disponibilité, de supposer avoir un accès panoptique à l’ensemble de la littérature présente, il faudrait surmonter le danger de l’essentialisation, de la réification et de l’anthropomorphisation qui nous conduit à vouloir faire notre petit roman de la « Littérature », il faudrait croire dans l’illusion de la transparence du jugement, circonvenir le piège de discours nécessairement autoréalisateurs, refuser la tentation de l’ivresse des exercices de style à la Henri François Aguesseau... Est-il réellement tenable de tenir un discours, quel qu’il soit, sur la situation présente de notre littérature – et peut-être sur quelque littérature que ce soit à quelque moment donné –, qui ne relève pas d’un jugement impressionniste ou d’un consensus transitoire, tant la construction des Panthéons de l’histoire littéraire et l’attribution de valeur se révèle, pour la cléricature universitaire comme pour la critique mondaine, une entreprise hasardeuse ?" (Alexandre Gefen, «Ma fin est mon commencement : les discours critiques sur la fin de la littérature», LHT [En ligne], N° 6, LHT, Dossier, mis à jour le : 10/06/2009, URL : http://www.fabula.org/lht/6/dossier/118-gefen.)
LES VEILLEURS - Vincent Message
MESSAGE, Vincent.
Les Veilleurs. Seuil. 2009. EUR 22,00.
On termine ce roman comme on en termine avec une pressante envie d’uriner – en hâte, un peu en catastrophe, en tout cas dans la satisfaction soulagée d’y avoir mis un terme. Ces 630 pages sont une indigestion logorrhéique, une soupe au solipsisme et à l’empirisme réaliste, un prêche mille fois avorté et recommencé, une plâtrée bourrative et fade qui laisse repu et indolent comme un après-midi dominical.
Une ribambelle de personnages stéréotypés pour lesquels notre affection ne peut qu’être concave ; des effets de deus ex machina scolaires pour évacuer des personnages devenus trop nombreux et des situations alambiquées dont le filon narratif est devenu trop ténu pour continuer à être exploité ; des dialogues (la narration est plus réussie) bancals aux phrasés maladroits et aux registres schizophrènes dans la bouche de personnages banals ; une diarrhée de mots dont le but est de servir de crachoir à un questionnement existentiel et à la fougue dualiste et absolutiste de l’auteur dans la vingtaine; des situations inconcevables, superflues et claudicantes qui épousent de trop près l’idée whartonienne « des mouvements irréguliers et dénués de pertinence de la vie »… notre auteur a peut-être oublié que le roman n’est pas la vie ni même une représentation fidèle de la vie et nous livre ce que Julian Barnes appelle « un roman ennuyeux et picaresque jusqu’à l’illisibilité » ; des enchaînements pour la plupart boiteux, des hésitations à faire coexister des mondes, des noms propres, des faits historiques réels et fictifs, une hispanisation incompréhensible et déroutante des noms de lieux et de personnages. Ces tares n’empêchent pas quelques rares moments de grâce même s’ils n’aboutissent pas… la diatribe contre le monde pensant et ses serviteurs cloîtrés dans leur citadelle dorée, l’abrutissement souriant de la réalité post-post-moderne, quelques réflexions bien senties sur l’imaginé et le réel. Mais leur exploration reste elliptique et insuffisante, et somme toute assez consensuelle. L’observation faite sur le malaise de la vie moderne demeure au niveau de l’apostille, au mieux, ressemble à la pépite en strass accrocheuse mais creuse d’un titre de Philosophie Magazine, et se complaît dans la constatation et s’accompagne malheureusement d’une représentation manichéenne : le rationnel vs. l’imaginé, l’incrédule vs. le naïf, la raison vs. le rêve. Cela manque cruellement de nuance, ce qui aurait pu être excusable si ce n’était pour le ton tonitruant, moralisateur et péremptoire avec lequel l’auteur a choisi de ponctuer son récit.
Ce roman semble vouloir tendre vers les meilleurs mais échoue lamentablement. On pense à un Zarathoustra pour pseudo-intellectuels cathodiques, on aurait préféré relire Les Fleurs Bleues de Queneau. On s’attèlera plus volontiers à Garcia Marquez et à Réjean Ducharme, aux vortex de leurs mondes parallèles : leurs marginaux, leurs désocialisés, leurs critiques et leurs états de rêve sont beaucoup plus riches, complets et prenants. Nous sommes très loin du page turner et plus près du somnifère en suppositoire pour objectophiles. Mais que l’on se rassure, cet ouvrage complètera astucieusement la panoplie d’outillage des amateurs de fleurs pressées.
LA CENTRALE – Élisabeth Filhol
FILHOL, Élisabeth. La centrale. POL. 2010. EUR 14,50.
Le roman se voudrait coup de poing, éclair de lucidité vif et forant. Lapidaire. Dépouillé. La narration est laconique et virile… pour traiter du nucléaire autre chose aurait été de par trop baroque. Malheureusement le coup de poing n’atteint pas les parties vitales du lecteur. On accuse un léger essoufflement, un vacillement estomaqué mais la narration n’a jamais vraiment la main haute sur nos consciences flageolantes de bienheureux gavés à une électricité facile. Mais peut-être n’est-ce pas son but finalement ? On peut applaudir le récit à hauteur d’homme qui coule fluide et limpide, sans états d’âmes rebutants. Une poésie ordinaire qui réussi à happer malgré l’aridité technique du sujet. Pas de sexe, pas de paillettes, pas de brio au néon, pas de fioritures, ce qui fait apercevoir d’autant plus clairement la violence sourde et muette du monde des sacrifiés sur le bûcher du plus grand nombre, de l’efficacité, de la facilité, de la consommation et du rendement. On aurait tout de même souhaité une claque plus cinglante.
ON NE BOIT PAS LES RATS-KANGOUROUS – Estelle Nollet
NOLLET, Estelle. On ne boit pas les rats-kangourous. Albin Michel. 2009. EUR 19,50.
Le rat-kangourou est un rongeur solitaire, fouisseur et nocturne qui se déplace par bonds pouvant atteindre jusqu’à 28cm de long, bouffe des insectes et des graines, boit très peu d’eau et dont la période de gestation dure 30 jours. Un petit rappel nostalgique des pocket mice des prairies canadiennes qu’on retrouvait affouillant dans les réserves mal refermées d’avoine pour dadas. Ce roman a au moins eu le mérite de me rappeler ce souvenir équestre ou d’hétéromyidés… c’est selon. Mais en ces temps de gargarisme nombriliste aux teintes mélancoliques d’un trop doux passé il n’est nul besoin d’un roman pour ce faire.
Un huis-clos auquel on ne croit pas une minute, tellement l’enjeu des personnages comme de la narration est flou. Pas d’enjeux. Pas d’histoire. Du moins, pas d’histoire qui tienne la route… b.a.B.-A. de tout cours en création écrite. Au lieu, on a droit à un enchaînement de biographies de personnages qui surgissent d’un décor de carton-pâte crade à la queue-leu-leu, quêtant existence au sein du récit, telles des brèves de comptoir trop apprêtées. Certains en viennent même à déblatérer alors que la narration ne leur avait encore rien demandé. Un narrateur homodiégétique et omniscient guère attachant auquel on ne comprend pas la quête. Un contour psychologique camus qui ne justifie pas le ressort narratif sur lequel l’auteure a tenté de le poser pour le propulser… vers quoi ? Une plus grande connaissance de l’être ? Une justification de son existence ? Une fuite vers un ailleurs prometteur ? La banalité de la tragédie parentale n’opère pas en tant que justification de l’hybris du personnage principal. Tout au plus une casserole de plus à accrocher à la patte d’un personnage boiteux pris dans les engrenages d’une histoire boiteuse.
La fuite dans les montagnes avec découverte de la vérité si longuement recherchée par des personnages décharnés à bout de forces sous l’égide d’une figure mystique chapeautée et le crétin pas si crétin que ça après tout – le Morgan Freeman et le Forrest Gump du pauvre… Au bout du chemin la liberté. Des insurgés traîtres et sanguinaires gavés d’un pouvoir illusoire qui finissent mal… Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers – le Henri Fonda (Il était une fois dans l’Ouest) ou le Clint Eastwood (Impitoyable) pour zombies indigents et désocialisés. Un éclair de lucidité dans le désert, bienheureux les simples d’esprit, rédemption de losers en cascade, l’amour pour déguiser le désastre et panglossisme contemporain. Au bout du compte, on ne sait plus dans quel conte on se trouve. Un « gloubi boulga » de références bibliques, de westerns spaghettis et de scénarios hollywoodiens, de récits voltairiens. Un foutoir narratif que la fin laisse pantois de consternation. Une « finalité sans fin » kantienne. Emprunt hasardeux du storytelling américain sans aucun enjeu, un dénouement estropié qui présage un mauvais téléfilm, le tout maquillé sous un langage viril et vigoureux qui essaie de faire passer le reste, tel un édulcorant une mousseline industrielle lyophilisée en boîte à reconstituer au micro-onde à chaleur haute. On n’hésitera pas à relire Heart of Darkness et Lord of the Flies pour se refaire une santé.



 Robe Ellis Island C'est Dimanche... lin chiné noir et blanc, fleurs en pliage origami à la Max Mara en taffetas de soie lourd noir
Robe Ellis Island C'est Dimanche... lin chiné noir et blanc, fleurs en pliage origami à la Max Mara en taffetas de soie lourd noir Marinière Oliver + S en coton chambray surpiqué en écru, boutons vintage à ancre marine
Marinière Oliver + S en coton chambray surpiqué en écru, boutons vintage à ancre marine
 Pantacourts à pont Oliver + S en métis lin/coton marron quadrillé, boutons vintage en bois
Pantacourts à pont Oliver + S en métis lin/coton marron quadrillé, boutons vintage en bois
 Petit haut à bretelles IPE en batiste de coton blanche à plumetis
Petit haut à bretelles IPE en batiste de coton blanche à plumetis

 Pantalons bac à sable Oliver + S en lin naturel
Pantalons bac à sable Oliver + S en lin naturel