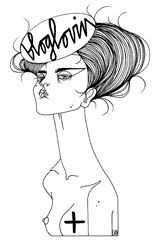Visiblement la médiocrité vient en kyrielle. Pour ceux qui ont loupé la
première installation de ce feuilleton tragique, en voici la suite. Je me félicite d'être enfin venue à bout de cette mortification
littéraire totalisant 2119 pages d'indigestion. Bientôt les festivités de la récompense où les notables locaux et les lauréats feront gorges chaudes de petits fours et d'une toute confidentielle exposition médiatique en cette riante ville de Blois. Je lève mon verre à cette perspective prochaine de description wittgensteinienne. Tchin! Tchin!
HHhH – Laurent Binet
BINET, Laurent. HHhH. Grasset & Fasquelle. 2010. EUR 20,90.
A-t-on vu procédé plus grossier! De plus sublime gâte-papier ! Une sainte horreur de A à Z. Sans doute l’un des pires ouvrages de la sélection. Vu le niveau de l’assortiment, l’insulte est suprême. J’ai eu le malheur d’entendre louanger cet ouvrage un peu partout, notamment dans une pizzeria en attendant la carbonisation complète d’une Regina un soir de phlegme dînatoire… et depuis une phrase de Voltaire me taraude : « Quand la populace se mêle de raisonner, tout est perdu. » (« Lettre à M. Damillaville », 1er avril 1766, dans Œuvres de Voltaire, Voltaire, éd. Lefèvre, 1828, t. 69, p. 131)…
Le quidam restera bluffé devant l’A.O.C. de l’auteur… « Laurent Binet a 37 ans. (…) Agrégé de lettres… » Ce soi-disant gage de qualité avec lequel l’éditeur veut nous étouffer devrait a contrario nous pousser à nous poser de sérieuses questions sur la validité aussi bien qualitative que qualificative du concours de l’agrégation – obole désuète d’un autre temps, dont on utilise encore l’aura auprès des masses lisantes, procédé habituel de la mythification française. « La tradition, ça a du bon » disait le slogan d’une pub. M. Binet, auteur, élevé au bon grain des concours… Bon, passons sur le procédé, qui relève d’une stratégie éditoriale plutôt que stylistique.
On s’étonnera néanmoins qu’un tel individu, puisque maintenant nous ne pouvons plus ignorer cet aspect biographique intervenant dans le fameux « pacte de lecture » et autre « horizon d’attente », rompu à la terminologie de l’analyse littéraire, fasse régner un tel brouillamini sur des concepts aussi essentiels que vérité historique, fiction, imaginaire et j’en passe. L’incipit est désespérant de sottise. « Je réduis cet homme au rang de vulgaire personnage, et ses actes à de la littérature : alchimie infamante mais qu’y puis-je ? (…) J’espère simplement que derrière l’épaisse couche réfléchissante d’idéalisation que je vais appliquer à cette histoire fabuleuse, le miroir sans tain de la réalité historique se laissera encore traverser. » Et beaucoup plus loin, « Les gens qui ont participé à cette histoire ne sont pas des personnages ou en tout cas s’ils le sont devenus par ma faute, je ne souhaite pas les traiter comme tels. » C’est très mal comprendre le principe même de l’Histoire et celui de la fiction. Quelques bonnes âmes organiseront-elles une quête pour payer à cet auteur Histoire et vérité de Ricoeur ?
L’auteur, de son propre aveu, juge son récit maladroit et ridicule, citant une flopée d’auteurs et de cinéastes beaucoup plus compétent en la matière. Je veux bien le croire. Mais pourquoi diable avoir persisté et signé si ce n’était pour la vulgaire satisfaction égomaniaque de voir imprimé son patronyme sur du carton jaune meringué ? Cet aveu aurait pu être touchant s’il ne puait pas si fort l’habituelle mode parisianiste de la mise en scène du dénigrement et de l’étalage solliptique de pseudos-intellos dont la posture scoliotique les mène à fixer le trou qu’ils ont au milieu du bide qu’a laissé un ancien, flétri et regretté cordon ombilical. La chorale médiocre. La catharsis dans l’auto-persiflage. L’auteur est dans l’impossibilité d’élaborer son récit sans y caracoler dans toute sa splendide petitesse. Très loin de l’exercice de style réussi, et plus loin encore d’une exploration aboutie et réfléchie sur les procédés de l’écriture, ces couinements masochistes restent tout bonnement, couinements masochistes. L’insistance surtout à faire l’éloge de ses conquêtes féminines, sa slavophilie, l’abrégé des charmes de la femme de l’Europe de l’Est sont particulièrement débecquetants et ressemblent aux toutes aussi lamentables trouées littéraires d’un autre auteur trentenaire de son genre, Philippe Vilain. Cette femme est désespérément réifiée au travers d’une célébration saccharique post-goethienne ou confinée au rôle de figurante éternelle (bien malheureuse Natacha !) L’auto-flagellation faussement compensatrice de l’auteur fait qu’on peut lui souhaiter des relations plus « charnues en parité » à l’avenir ou tout au moins, s’il persiste à écrire, à abandonner l’artifice du loser qui fait le catalogue de ses compagnes pour s’attirer la sympathie du lecteur.
De par sa teneur historique, certains se sont enquis de savoir (en réunion publique) si ce livre était bien un roman. Force est de constater que ces considérations génériques ne sont d’aucune validité et fournissent tout au plus les prémisses à une fausse polémique. Qu’est-ce que le « roman » sinon un simple élément taxinomique qui permet la classification du livre par ses « professionnels » et fonctionne « comme un schéma de réception (…) comme code littéraire, ensemble de normes, de règles du jeu [informant] le lecteur sur la façon dont il devra aborder le texte, [et dont la réalisation devrait inviter] à corriger la vision conventionnelle qu’on a du genre dont le texte serait la réalisation, comme langue sous-jacente au texte considéré comme parole. » (Antoine Compagnon. Le démon de la théorie. Seuil. 1998.) Les contraintes génériques sont une accumulation de conventions historiques. Une relique millénaire en somme. Le genus dicendi. Une béquille de l’Antiquité qui rend infirme quiconque insiste à s’y appuyer dessus. Un détritus aristotélicien qui fait se vautrer ses partisans dans la triade carcérale du sublime, du tragique et du grotesque… l’histoire, la romance et la satire… le haut, le moyen et le bas… ce que Barthes appelait la travaillée, la neutre, la parlée. Et ce n’est pas dans les références visant à élucider le statu quo du roman et gentiment fournies par les organisateurs du Roblès que la lumière surgira, tant on y retrouve aussi bien des ouvrages de sémiotique illisibles que des enfantillages bienveillants.
L’enchaînement de faits historiques plus ou moins romancés et grossièrement raccordés par la mise à nu des engrenages d’écriture en fait un roman, certes, mais un roman malhabile où les personnages, en dépit du bruit qu’en fait l’auteur, ne sont guère attachants parce que plats, interchangeables et indistincts. L’écriture est molle et insipide. L’auteur tente de la faire tenir dans un corset de termes savants. Il nous fait l’inventaire de tropes et de figures de style pour assurer la mainmise sur son herméneutique… métonymie, uchronie, autonomase… tout y passe. Mais nous ne sommes pas une de ses classes de terminale en Seine-Saint-Denis. L’effet final est des plus rasoirs. Une flaque informe. On se taperait (oh ! cruelle punition !) plus volontiers une soirée consacrée à l’Allemagne nazie sur ARTE.
FOURRURE – Adélaïde de Clermont-Tonnerre
CLERMONT-TONNERRE, Adélaïde de. Fourrure. Stock. 2010. EUR 23,00.
J’ai interrompu une lecture de SuperDupont pour feuilleter cette touaille… le gouffre est vertigineux. On peut légitimement craindre pour l’avenir des Lettres françaises. « Nous cultivons depuis longtemps une tradition française des prophètes du désastre et des pleureuses de la culture. La défaite de la pensée est notre muse familière de la délectation morose. Nous nous lamentons sur la faillite de la haute culture, sur l’échec de la démocratisation des arts, sur la fin de l’humanisme, sur la ruine de l’école, sur l’envahissement par la culture de masse et l’industrie du divertissement. Aucun autre pays n’est à ce point fasciné par la déchéance de la langue. » (Antoine Compagnon. Le souci de la grandeur. Denoël. 2008.) Réjouissons-nous en ! S’il existe toujours la capacité dans ce pays parmi quelques-uns de trier le grain de l’ivraie, ne tombons pas dans les travers inverses qui consisteraient à applaudir béatement tout ce qui a le malheur d’être publié. Avec ce livre, « la chose littéraire » comme dirait Sainte-Beuve, « semble de plus en plus compromise ».
On se contrefout comme d’une guigne ou de Johnny ou des gros queutards de l’équipe de France, de cette narration faite de bluettes, de copier-coller venus tout droit de la collection Arlequin, de name-dropping laborieux et godiche… Les personnages auraient pu être emmaillotés de cachemire beige taupé signé YSL comme avoir les mamelles étranglées dans un corsage en Élasthanne de chez Monoprix, cette nommagite bruyante est narrativement nulle et pesante à la lecture. On peut parler de perturbation de la communication littéraire. Cette communication littéraire implique nécessairement que « le lecteur et l’auteur participent, au moins dans une certaine mesure, à un même code esthétique (…) socialement [marqué et renvoyant] à des processus d’inculcation culturelle. » (Emmanuel Fraisse & Bernard Mouralis. Questions générales de littérature. Seuil. 2001.) certes ! Mais de là à nous imposer un matraquage du who’s who du Paris mondain, il y a tout un gouffre.
Des personnages plats (c’est une plaie contemporaine que de ne pas savoir tracer des personnages qui aient un tant soit peu de substance ?!) frappés par le sceau du stéréotype ; mises en abîme du lecteur et du livre, récit enchâssé, questionnement sur la fiction qui font couac tellement les artifices sont lourdingues ; dialogues de feuilletons nicaraguayens qui se voudraient brillants, se gargarisant de leur propre platitude et faisant penser à du Noel Coward paraplégique ; enjeux narratifs inexistants, incongruités anaphoriques de construction. Thèmes et rhèmes sont sans intérêt. Aucun. On se retrouve noyés dans des inepties sacchariques de soap-operas érotiques et les élucubrations ontologiques frustes d’ado égotique frustré par un cerveau pas encore terminé et des hormones qui font ravage.
Je reprends SuperDupont là où je l’ai quitté. Pour me laver les yeux.